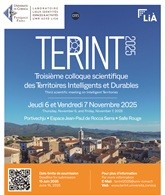La supervision classique des systèmes informatiques atteint aujourd'hui ses limites. Elle signale une défaillance manifeste à travers des indicateurs figés (disponibilité, charge, temps de réponse), mais reste insuffisante pour expliquer en profondeur ce qui fragilise un système.
Ainsi, l’observabilité, associée à l’intelligence artificielle (IA), prend toute sa valeur pour comprendre, anticiper et contenir les incidents avant qu’ils n’affectent l’usager. Pour une collectivité, cette approche est essentielle afin d’assurer la continuité de services numériques critiques tels que les plateformes de démarches en ligne, les systèmes de gestion des déchets ou les applications de mobilité urbaine.
Des usages massifs et des infrastructures sous tension
La moindre interruption ou latence suffit à nourrir l’insatisfaction et à fragiliser la confiance dans l’administration numérique. Sans observabilité, difficile de distinguer un pic normal lié au calendrier fiscal, d’un dysfonctionnement annonciateur d’incident. Dans les collectivités, cette distinction est tout aussi cruciale : un ralentissement du portail scolaire ou du service d’état civil en ligne peut résulter d’une affluence saisonnière, ou signaler une attaque en préparation.
À cette pression d’usage s’ajoute un risque croissant d’attaques. Rien qu’au premier semestre 2025, plus de 3,2 millions d’attaques DDoS ont été recensées en Europe. De plus, l’ENISA confirme que les administrations publiques sont en première ligne, concentrant près de la moitié des attaques par déni de service observées.
En France, les collectivités territoriales sont directement concernées. En 2024, l’ANSSI a enregistré 218 incidents les visant, soit une moyenne d’environ 18 par mois. Le Sénat souligne d’ailleurs que « les collectivités territoriales sont en effet des cibles de choix » pour les acteurs malveillants, en raison de systèmes d’information souvent fragmentés et difficilement cartographiés, et de données administratives ou financières particulièrement convoitées.
Cette exposition, accentuée par la dépendance croissante aux services numériques, rend indispensable une visibilité continue sur les infrastructures. Cela révèle les limites des outils traditionnels et ouvrent la voie à l’observabilité, renforcée par l’IA.
Observabilité et IA : des approches complémentaires
D’une part, l’observabilité va plus loin que la supervision « classique ». Elle associe en continu métriques, événements, logs et traces pour fournir une vue holistique des systèmes. Elle permet également de corréler différents signaux et de révéler les causes profondes d’un ralentissement ou d’un incident. En clair, cela ne signale pas uniquement une lenteur du service mais explique aussi où, pourquoi et comment le problème survient.
D’autre part, l’intelligence artificielle vient renforcer cette démarche. Par l’analyse automatisée de volumes massifs de données et l’usage de techniques comme l’inspection approfondie des paquets, elle détecte des anomalies, identifie des comportements suspects et hiérarchise les alertes. Là où une intervention humaine prendrait plusieurs heures, un système d’IA correctement entraîné agit en quelques secondes. Ces capacités s’avèrent essentielles pour les équipes IT locales, souvent réduites, qui doivent surveiller en continu des flux multiples : téléservices citoyens, messageries internes, capteurs connectés, outils collaboratifs.
Cependant, l’IA ne peut jouer ce rôle qu’appuyée sur un socle d’observabilité, car c’est cette dernière qui fournit les données de qualité et le contexte nécessaire pour distinguer une anomalie critique d’un bruit de fond. Ensemble, elles permettent non seulement de réagir, mais aussi d’anticiper : prévoir des goulots d’étranglement, détecter les prémices d’une attaque, ou encore optimiser l’usage des ressources.
Gouvernance et confiance
La montée en puissance de l’IA dans des systèmes critiques pose aussi une question de gouvernance. Le rapport publié en juillet 2025 par Le Sens du service public et la Fondation Jean-Jaurès insiste sur trois conditions : supervision humaine, finalité clairement définie et transparence sur les données employées. Des exigences reprises par l’AI Act européen, qui classe de nombreux usages publics comme « à haut risque ».
Pour accompagner cette transition, l’INESIA (Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’intelligence artificielle) a été créé pour aider les administrations à évaluer leurs projets, à comprendre les risques techniques et à garantir leur alignement avec les standards européens. Enfin, le Sommet mondial sur l’IA organisé à Paris a rappelé que la confiance repose autant sur la technologie que sur sa gouvernance.
Les collectivités locales, en première ligne de la relation citoyenne, peuvent incarner cette confiance : en s’appuyant sur des outils d’observabilité et d’IA fiables, elles assurent la continuité, la sécurité et la performance de leurs services numériques, tout en renforçant la résilience du territoire.
Pour les services publics, l’alliance entre observabilité et IA devient ainsi le socle de la résilience et de la sécurité des infrastructures numériques. Elle prépare surtout une administration capable de faire face à l’augmentation des usages, de contenir des menaces toujours plus sophistiquées et d’installer une confiance durable dans l’État numérique.